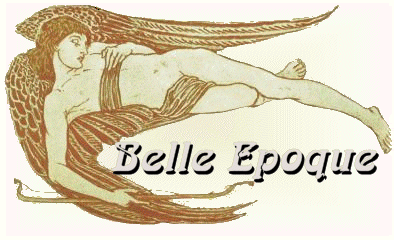La Belle Epoque en Europe
Danemark/Suède: Film muet de niveau mondial
Danemark

Au début du siècle, le Danemark était un des pays les plus importants du film mondial. Son pionnier cinéaste était Ole Olsen (1863-1943), fondateur de la Nordisk Films Kompagni (1906), qui pendant longtemps avait une influence considérable sur le film européen. Le premier film qu'il avait produit était Løvejagten paa Ellore (La chasse au lion à Ellore, 1907) où l'on poursuit la chasse à un vieux lion de cirque de façon réaliste. Mais bientôt, on tournait des films plus exigeants: En 1913, August Blom (?-1947) faisait Atlantis d'après Gerhard Hauptmann, Holger Madsen (1878-1943) tournait en 1916 Ned med vaabene (A bas les armes) d'après le roman de Bertha von Suttner et en 1918 Himmelskibet (Bateau du ciel), un des premiers films de science fiction.
Mais les plus grands succès économiques du film danois se réalisaient grâce à des comédies burlesques dans des milieux les plus exotiques possibles dans lesquelles l'érotisme jouait un rôle assez étonnant pour l'époque. Des films comme Maharajaens yndlingshustru (L'amante préférée du maharadja, 1916) de Robert Dinesen (1874-1942) ou Tempeldanserindens elskov (L'amour de la danseuse du temple) de Holger Madsen étaient des succès mondiaux. Mais c'étaient moins les réalisateurs que les acteurs qui contribuaient à ces succès du film danois. Valdemar Psilander (1884-1917) qui s'est suicidé à l'apogée de sa carrière et Olaf Fønss (1882-1949) qui plus tard continuait sa carrière en Allemagne étaient connus et populaires dans le monde entier.
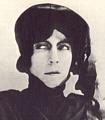
Mais la plus grande découverte du film danois était sans doute Asta Nielsen (1881-1972) qui en 1910 sous la mise en scène de Urban Gad (1879-1947) débutait dans le film Afgrunden (L'abîme). Au fait, avec ce film, elle voulait simplement attirer l'attention des directeurs de théâtre, mais au lieu de cela, elle devenait une vedette mondiale pour laquelle le public, les critiques et même les poètes s'enthousiasmaient. Mais déjà un an après sa découverte, Asta Nielsen quittait sa patrie et poursuivait sa carrière triomphale en Allemagne jusqu'en 1916 et encore pendant les années vingt.
Etrange à dire, mais les deux réalisateurs danois les plus importants de l'époque, Carl Theodor Dreyer (1889-1968) et Benjamin Christensen (1879-1959), avaient une influence moins importante sur le film danois que les artisans agiles. En 1913 déjà, Christensen débutait avec le film d'espionnage Det hemmelighedsfulde X (Le X mystérieux), et il remportait ses premiers lauriers internationaux avec son film d'épisodes Blade af satans bog (Des pages du livre de satan, 1920). Mais alors, le vrai apogée du film danois était déjà passé. Ainsi, Dreyer travaillait plusieurs fois à l'étranger - en Norvège, en Suède, en Allemagne et en France où il créait avec La passion de Jeanne d'Arc (1928) un des film muets les plus fameux.
A cette époque-là, le film danois avait déjà atteint l'insignifiance. Dans le monde, on ne connaissait plus que Doublepatte et Patachon, Carl Schenstrøm (1881-1942) et Harald Madsen (1890-1919), qui pendant longtemps étaient les comédiens les plus fameux et populaires de l'Europe.
Suède

Avec le déclin du film danois commençait la montée de l'art cinéaste suédois représenté surtout par les réalisateurs Victor Sjøstrøm (1879-1960) et Mauritz Stiller (1883-1928). Autour de 1912, tous les deux avaient commencé de tourner des films, et tous les deux avaient d'abord imité les films danois. Sjøstrøm était le premier à se libérer de ces exemples. Avec les films Terje Vigen (1916) et Berg-Eyvind och hans hustru (Berg-Eyvind et sa femme, 1917), il avait trouvé son propre style et en même temps il donnait son empreinte au «style scandinave» qui alors influençait de nombreux cinéastes en Europe et aux Etats-Unis. Sjøstrøm racontait des histoires simples, maintes fois d'après des romans de Selma Lagerløf, avec une action dramatique en ligne droite. Mais surtout il réussissait à peindre des tableaux de nature réalistes qui n'étaient pas une décoration accidentelle mais élément important de l'action. Sjøstrøm prouvait aussi de l'adresse et du goût en exposant l'irréel. Par exemple, dans son film Ingmarssønerna (Les fils d'Ingmar, 1918), d'après la première partie du roman Jérusalem de Selma Lagerløf, il y a une scène fameuse dans laquelle les protagonistes demandent conseil aux ancêtres dans les cieux. Et encore dans Kørkarlen (1920), par des moyens visuels, il produit une atmosphère intégrant le surnaturel de façon convaincante.

En 1922, Sjøstrøm allait à Hollywood où il réalisait d'autres films remarquables. Quand ils retournait en Suède en 1930, l'apogée du film suédois était passé. Il ne réalisait plus qu'un seul film dans sa patrie.
Mauritz Stiller avait d'abord préféré des sujets semblables à Sjøstrøm mais les avait traités de façon moins lyrique et moins romantique que plutôt dramatique avec des effets vifs. Un de ses plus grands succès était l'adaptation de Herr Arnes pengar (Le trésor de M. Arne, 1919) de Selma Lagerløf. A part cela, il développait avec Riddaren av igar (1920) un genre de comédie cinégraphique qui entre autres fort influençait Ernst Lubitsch. Son film Gøsta Berlings saga (1923) était le début de l'actrice Greta Garbo (1905-1990). Avec elle, en 1925, Stiller allait à Hollywood. Après avoir eu peu de succès, il rentrait déçu en 1928 et mourait dans la même année. Avec l'engagement de Sjøstrøm et Stiller à Hollywood, la grande époque du film muet suédois était pratiquement terminée.